*** spoiler alert Tome 3 Le dôme de la méduse
Vous rêviez de dessiner vos propres symboles de la Huit-Population ? 🙂
Grâce à ce générateur (propriété de Universal Turtle Lab), vous allez pouvoir vous amuser !
Enjoy ! 🤓

07 dimanche Avr 2024
Posted in Non classé
*** spoiler alert Tome 3 Le dôme de la méduse
Vous rêviez de dessiner vos propres symboles de la Huit-Population ? 🙂
Grâce à ce générateur (propriété de Universal Turtle Lab), vous allez pouvoir vous amuser !
Enjoy ! 🤓

30 samedi Mar 2024
Posted in Anecdote
(*** spoiler alert Tome 3 ***)
En octobre 2023, la NASA a publié un guide des meilleures pratiques pour sécuriser ses missions spatiales (satellites, rover, fusée, etc.) Ce document est public et consultable ici : https://swehb.nasa.gov/display/SWEHBVD/7.22+-+Space+Security%3A+Best+Practices+Guide
Le paragraphe 3.2.2.6.2 parle de l’intégrité des logiciels. Les missions doivent vérifier l’intégrité des logiciels embarqués dans les missions, de peur qu’un sabotage ait lieu : il ne faudrait pas que le logiciel d’un satellite ait été modifié par une tierce personne… Cela vous rappelle quelque chose ? Dans le chapitre 7 du Dôme de la méduse (Tome 3 de la trilogie baryonique), Slow comprends que les déboires du M-Orca (voir Le système de la Tortue , Tome 2) sont dus à une modification de logiciels de l’Expert. La faute à un test de contrôle bien prévu, mais non réalisé au sol : la vérification de l’intégrité des images logicielles. Comme quoi, la NASA s’inspire des contrôles sécurité de l’Agence de Recherche de l’Antimatière. C’est bien.
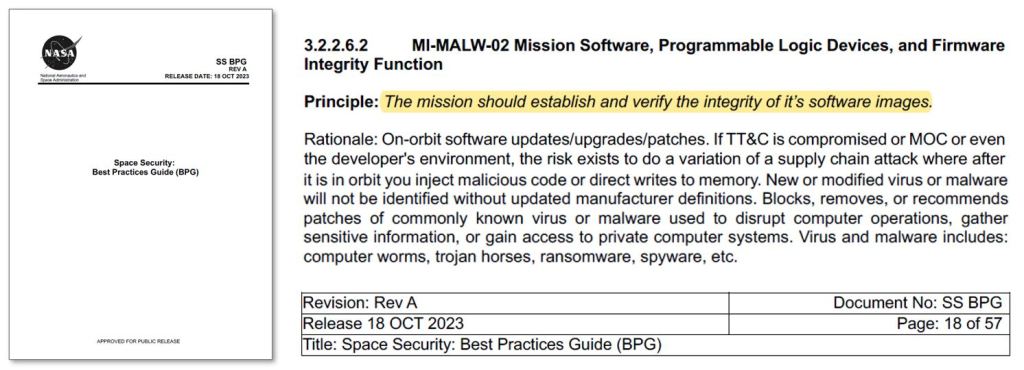
24 samedi Fév 2024
16 mardi Jan 2024
07 dimanche Jan 2024
Posted in Evènement
09 samedi Déc 2023
La trilogie baryonique a inspiré de nombreux peintres depuis la Renaissance. Le personnage de Ness (et sa passion pour les cactus) a été repris de nombreuses fois. La version de Vermeer (1657) ci-dessous est reconnaissable par les couleurs jaune et bleu, que l’on retrouve dans d’autres compositions du peintre, notamment sa très célèbre « Laitière ».

Une autre peinture imitant « La Cène » de Leonard de Vinci existe. On y voit Ness, à la place centrale de Jésus, entourée de cactus-disciples. Après une controverse en 1931 entre le marchand d’art parisien Carasco et le musée du Louvre, il a été prouvé que cette toile était un faux, peint au début du XXe siècle.
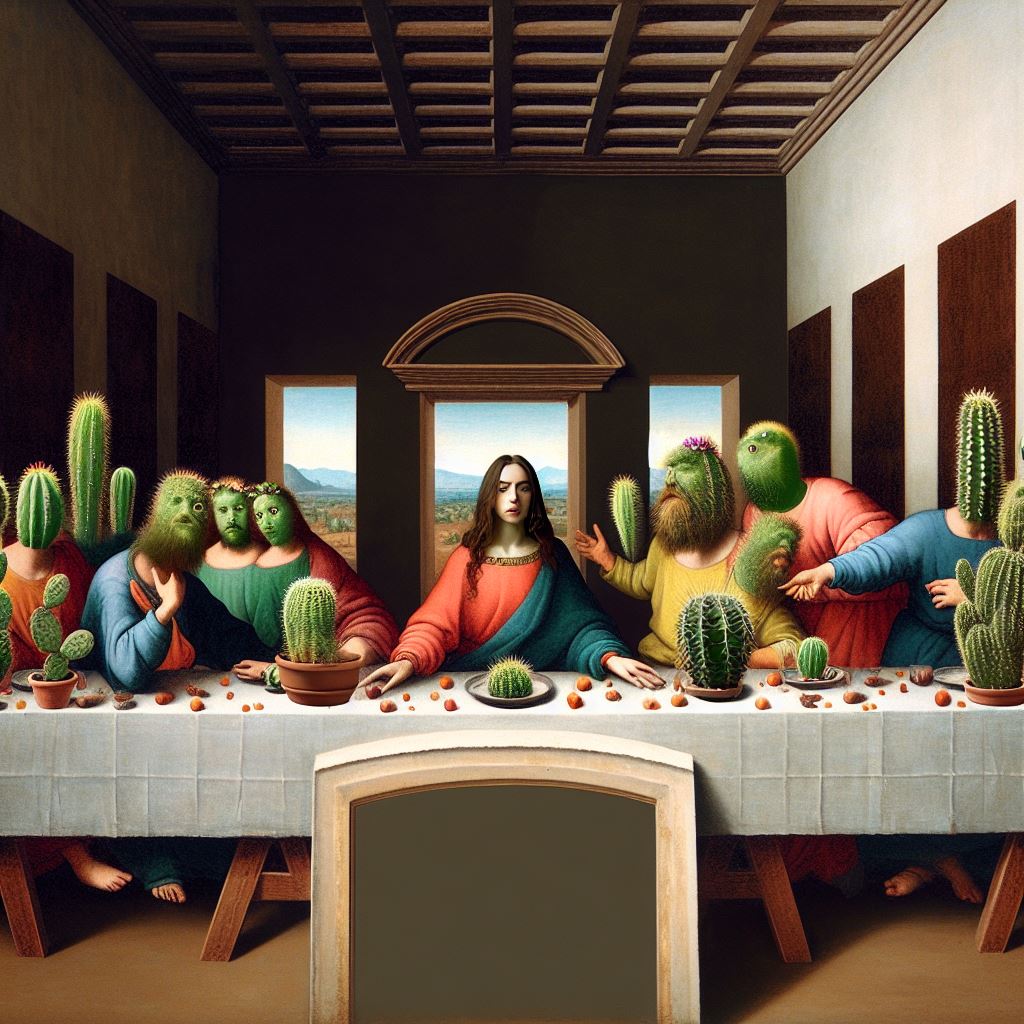
En revanche, l’authenticité de ce portrait de Slow a été prouvé en 1981, par maître Espinasse (tribunal de commerce de la vallée de Chantebrie). On retrouve le fond similaire à celui de La Joconde, ainsi que la « patte » du maître.


« La Tragédie de l’orque » a durablement marqué Edvard Munch. Entre 1893 et 1917, il réalisera six versions de son fameux « cri ». Sa toute première version (la toile a été perdue lors d’un tournoi de Capateros en 1933) a été directement inspirée de sa lecture du premier tome de la trilogie. On y voit clairement le trou noir créé par inadvertance dans le système solaire par l’équipage de l’Orca-7131, source de l’effroi du personnage au premier plan.

A peu près à la même époque, l’impressionniste Claude Monet a peint toute une série de paysages inspirés de Tortue-B. Ces trois toiles ont été peintes en 1874, alors qu’il était à Bezons, 300 ans exactement avant la découverte de cette exoplanète. Tortue-A et Tortue-C sont représentés. La présence d’une troisième « lune » sur la toile de gauche a longtemps intrigué les experts.



Sur la dernière toile, on distingue un module e-Orcas au sol, preuve que Claude Monet avait déjà lu le troisième volet « Le dôme de la Méduse » en 1874.
Enfin, en 1932, Salvador Dali a repris l’univers de la trilogie baryonique pour composer cette toile pleine de symbole. On peut y voir le canari de Sara, la tortue en impesanteur de Slow, les Orcas sphériques et même une vision très poétique de la planète Tortue-B. La fuite liquide de l’Orca sur la gauche est une référence à peine voilée à sa toile « La persistence de la mémoire » (1931) ainsi qu’à la théorie de la Relativité générale (qui démontre l’existence des trous noirs)

03 dimanche Déc 2023
Posted in Analyse
Aujourd’hui, nous analysons comment le roman « La Fractale des raviolis » a inspiré les peintres à travers les époques.
Le Rat-taupe nu, personnage central du roman a inspiré Brueghel l’Ancien (1525-1569), à qui on doit plusieurs représentations de l’animal. Il faut comprendre qu’à la renaissance flamande, les autres thèmes abordés par le livre (adultère, crimes) étaient censurés par la religion. Le peintre s’est donc concentré sur l’étude de l’animal.

Malgré son sujet prosaïque, cette peinture a été vivement critiquée par l’église. Le sujet étant trop « terrien » et pas assez Divin. Dans une seconde toile, Brughel afflube donc le rat-taupe d’une main humaine qui pointe quelque chose dans le ciel : une divine apparition symbolisée par l’éclaircie.

Un peu plus tard, en 1634, Rembrandt (1606-1669), grande figure de la peinture baroque flamande, modernise le modèle. Une peinture « naturaliste » dont le peintre n’était pourtant pas habitué.

Il faudra attendre Vermeer (1632-1675) pour voir apparaître pour la première fois la représentation des raviolis empoisonnés. Sur cette toile désormais classique, on voit un homme manger de façon tout à fait anodine. Il faut remarquer sa bouche fermée et son air suspicieux : il ne mange pas mais renifle le ravioli ; l’amande en premier plan – rappelle l’odeur du cyanure et symbolise le poison. Symbole repris par les manches vert amande de sa veste. Les deux bougies indiquent le manque d’harmonie (il manque la troisième pour former la trinité) – cela renvoie au péché de l’homme (son adultère, non explicitement représenté).

A la même époque, une toile non identifiée, mais probablement peinte par un des élèves de Vermeer représente l’autre verso de la pièce : la femme préparant les raviolis. L’homme masqué sur la gauche représentant le mal, l’homme souriant sur la droite, la luxure. La femme semble appliquée, sûre de son geste qui s’avérera fatal.

Le thème des raviolis empoisonnés est resté un classique. Dans sa toile exposé au MET, Norman Rockwell (1894-1978) revisite le mythe en montrant cette fois-ci les deux protagonistes.

Cette toile peinte en 1952 a créé la polémique à cause du visage trop cruel de la femme. Les mouvements féministes de l’époque lui ont reproché une inversion des rôles. La femme bafouée se trouvait être la mégère d’un mari volage. Simple machisme ou complaisance de la part du peintre ?
Sa seconde toile (1954) reçut un accueil beaucoup plus favorable. L’épouse regarde son mari manger les raviolis empoisonnés d’un regard plein de regrets et d’amertume. Au fond, un homme regarde au travers de la vitre. Il symbolise la censure américaine en plein McCarthysme.

14 mardi Nov 2023
Posted in Evènement
En octobre, deux romans ont été adaptés en livre audio.
Les Embrouillaminis : ce roman « dont vous êtes le héros » n’était pas le plus simple à transformer en livre audio ! Mais pari tenu pour Lislemoi, qui a réussi ce tour de force via son application. L’expérience utilisateur est très bonne : à chaque fin de chapitre, il suffit de faire son choix. Lu par Aslân Guiassa et Gaston Poujol.

La tragédie de l’Orque, premier tome de la Trilogie Baryonique est également sorti chez Lizzie, lu par Philippe Sollier.
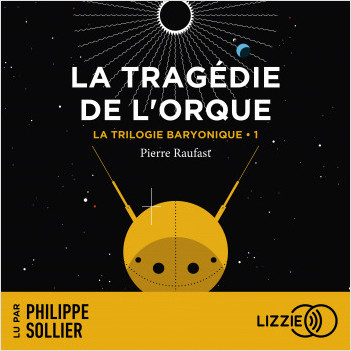
Vous ai-je dit que c’était bientôt Noël ? 😉
14 mardi Nov 2023
Les Utopiales est le plus grand salon de Science-Fiction d’Europe. Cette année, plus de 140 000 visiteurs sont venus du jeudi 2 au dimanche 5 novembre. Pour ma part, c’était ma première invitation et j’ai adoré !
Il y a eu d’abord le discours de Roland Lehoucq, son président. Fun Fact, sa leçon inaugurale a parlé d’antimatière : en plein dans le sujet de la trilogie baryonique ! 🙂

Ce salon, ce sont des dizaines de conférences, des courts et longs métrages, des ateliers d’initiation aux jeux de rôles, des démonstrations de jeux vidéos (dont le tout nouveau Goldorak !), la possibilité de peindre ses figurines, des boutiques, des expos, de la réalité virtuelle, sans oublier une gigantesque librairie de SF avec un coin dédicace.



J’ai participé à deux tables rondes, l’une autour de l’extinction de l’humanité (avec comme fil conducteur Battlestar Gallactica), et l’autre sur les archéologues du futur. Passionnant.
La tragédie de l’Orque, premier opus de la trilogie baryonique était dans la sélection du prix des Utopiales 2023. C’est le très bon livre « Rossignol » d’Audrey Pleynet qui a gagné.

Enfin, c’est l’occasion de rencontrer plein de mondes ! D’autres auteurs/autrices, Charlotte ma future éditrice Pocket, des libraires et des lecteurs/lectrices.

Bref, vous avez compris que cette édition des Utopiales 2023 m’a vraiment plu ! Hâte de pouvoir y retourner.
25 lundi Sep 2023
Posted in Non classé